Le Billet du lundi du 23/12/2019**, Par Jean-Philippe Duranthon*
La Belgique est sans gouvernement depuis un an (18 décembre 2018). En Espagne les élections législatives du 10 novembre, les deuxièmes de l’année, n’ont pas encore débouché sur la formation d’un gouvernement. Il en est de même en Israël après les élections du 17 septembre, elles aussi les deuxièmes de l’année. En Allemagne, les résultats des élections européennes ont fragilisé la « grande coalition », incité une frange du SPD à vouloir rompre l’alliance et réduit l’influence de la chancelière en Europe. Au Royaume-Uni les parlementaires ont réussi, durant un an, à écarter la mise en œuvre du Brexit alors que celui-ci avait été souhaité, lors du referendum du 23 juin 2016, par le corps électoral et que rien ne laissait supposer qu’il ait changé d’avis, comme les élections du 12 décembre l’ont confirmé. Aux Etats-Unis, les parlementaires démocrates sont parvenus à donner un contenu à leur volonté d’engager une procédure d’impeachment à l’encontre du Président. En Italie, deux partis ont, au mépris de leurs déclarations passées, contracté une alliance parlementaire boiteuse dans le seul but d’empêcher des élections qui, selon tous les sondages, les auraient exclus du pouvoir. En France une partie importante de la population ne fait plus confiance, pour exprimer ses opinions et défendre ses intérêts, aux parlementaires qu’elle a élus et privilégie manifestations et grèves.
Parfois, donc, le processus électoral ne permet pas la formation d’un gouvernement ; parfois les conflits entre institutions perturbent la mise en œuvre des choix électoraux faits ou probables ; parfois les élus sont contestés ou contournés.
Si ces difficultés des gouvernants ne sont pas nouvelles et constituent ce qu’il est de tradition d’appeler « le jeu démocratique », leur concomitance et leur généralisation dans les principales (vraies) démocraties occidentales (hors Europe du Nord) sont troublantes.
Ce qui importe ici, c’est que cette situation signifie un affaiblissement des gouvernants et la nécessité, pour eux, d’agir à courte vue. Pour eux la priorité est aujourd’hui d’affaiblir ou d’étouffer les germes de contestation interne et de déstabiliser ceux qui cherchent à les déstabiliser. Dès lors, gouverner ce n’est plus imaginer et organiser l’avenir, c’est se préparer à l’épreuve du lendemain, voire se tirer de l’embûche du jour.
Ce raccourcissement de l’horizon de l’action publique, cette perte de la dimension temporelle, sont lourds de conséquences pour l’action géopolitique. Celle-ci, en effet, ne peut être menée à bien que si les gouvernants sont crédibles et ont les moyens de leurs discours, et surtout si leur action s’inscrit dans la durée : les orientations diplomatiques peuvent peut-être changer avec les majorités électorales mais l’influence d’un pays, son poids géopolitique et ses atouts ne s’organisent pas aussi vite qu’une alliance électorale ou qu’une manifestation de rue.
Cette incapacité des démocraties électorales à agir dans la continuité temporelle, que l’actualité met en lumière, est d’autant plus frappante que d’autres pays – qui ont choisi d’autres modes de sélection de leurs gouvernants – y échappent : pour ne citer qu’eux, Vladimir Poutine est à la tête de la Russie depuis vingt ans et Xi Jinping de la Chine depuis sept ans, et dans les deux cas tout laisse prévoir que leur « mandat » est loin d’être achevé. Eux ont la possibilité d’inscrire leur politique dans la durée, de prendre des orientations qui nécessitent du temps pour produire leurs effets, de privilégier le temps long et non l’immédiat.
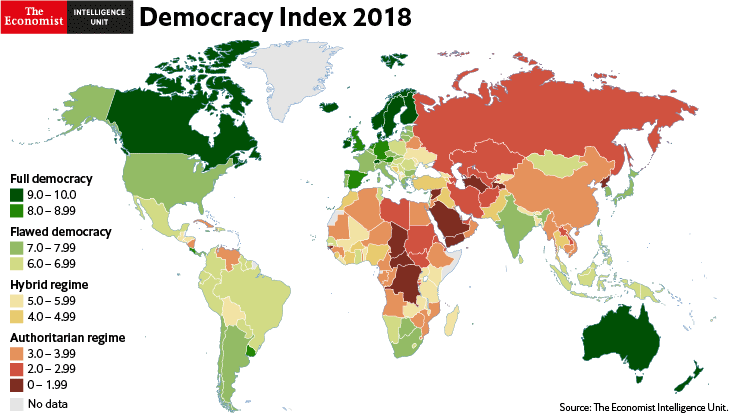
Dans la philosophie institutionnelle occidentale, l’élection a pour vertu de permettre, d’une part à chaque individu d’agir sur son destin, d’autre part à chaque gouvernant de disposer de la puissance que confère l’appui populaire. Il en résulte que, théoriquement, le débat entre gouvernements autoritaires et démocraties électorales oppose la force, souvent brutale, à la légitimité, inspirée par la Raison.
Ne risque-t-on pas qu’il oppose bientôt la force à la faiblesse ? Comment l’éviter ?
L’idéal, bien sûr, serait que le monde entier adopte les mêmes principes de gouvernement que les nôtres. C’était, après la chute du mur de Berlin, la certitude de Francis Fukuyama lorsqu’il écrivit The End of History and the Last Man en 1992 ou, en raison des nouveaux liens que créent, nonobstant les frontières, les technologies digitales, la conviction de Thomas Friedman, exprimée en 2005 dans The World Is Flat : A Brief History Of The Twenty-first Century. Mais l’être humain n’est pas une entité abstraite, il est chargé de culture et d’histoire. Le système politique occidental est l’héritier de la philosophie grecque, qui s’est interrogée sur la place de l’homme dans la société, de la pensée chrétienne, qui a promu le concept de valeurs dépassant les intérêts matériels individuels et collectifs, et des philosophes des Lumières, qui ont laïcisé ces valeurs. Est-il raisonnable d’imaginer que les populations des pays, voire des continents, dont l’histoire, la culture et les valeurs sont autres, abandonneront collectivement leurs systèmes de pensée pour adopter le nôtre (qui, bien sûr, continuera d’évoluer) ? A supposer qu’on confonde réalisme et optimisme, une telle conversion aux valeurs occidentales prendrait du temps, davantage encore que n’en prennent les évolutions géopolitiques.
L’autre voie de progrès serait de chercher à refonder au niveau européen la légitimité électorale occidentale. On pourrait distinguer la gestion du temps court, qui serait confiée aux gouvernants nationaux, et celle du temps long, qui serait traitée à l’échelle européenne qui peut sembler davantage en prise sur les grandes évolutions mondiales. Mais cette répartition des rôles est bien illusoire, car la gestion du temps long a besoin de s’ancrer périodiquement dans le réel. Surtout, les nouvelles instances européennes sont au moins aussi fragiles que les institutions nationales : la Commission n’a pu être constituée que dans la douleur, le Parlement, désormais partagé entre quatre forces politiques, aura du mal à former des majorités stables et le Conseil ne peut que constater la pluralité des conceptions partagées par ses très nombreux membres. Tant que l’Europe n’aura pas de véritable leadership et devra composer avec des procédures bureaucratiques, il est peu probable que ses dirigeants soient en mesure de « voir loin ».
C’est donc nécessairement au sein des Etats qu’il faut chercher aujourd’hui une solution permettant de relever le défi que pose le rapport de forces entre les démocraties électorales et les Etats autoritaires. Il est indispensable que les premières retrouvent la maîtrise du temps long, sortent de la dictature de l’immédiateté. Le sujet, à l’évidence, dépasse la seule problématique géopolitique. Raison de plus pour que le débat soit lancé et pour que ses différents volets – institutionnels, économiques, technologiques, diplomatiques, culturels – soient identifiés et discutés. Cela suppose des analyses évoquant sans fard ni tabous les réalités présentes et futures, auxquelles les think tanks, tel Geopragma, peuvent contribuer. Cela passe par l’élaboration de scénarios concrétisant les conséquences des différents choix possibles. Cela nécessite aussi que d’aucuns, après avoir obtenu qu’on se soucie au moins autant des fins de mois que de la fin du monde, admettent que les fins de mois de demain doivent être préparées dès aujourd’hui.
*Jean-Philippe Duranthon, membre fondateur de Geopragma
**Ce Billet devait être publié le 23 décembre 2019. Le site ayant été en maintenance, il n’a pu l’être que le 28 décembre 2019. Nous vous adressons nos excuses pour ce désagrément.






